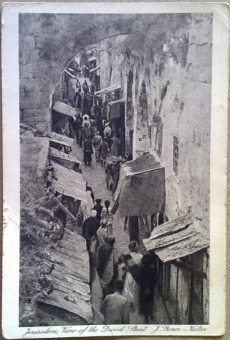60 ans de conflit israélo-arabe par Boutros Boutros-Ghali et Shimon Perès
II – NAISSANCE D’ISRAËL, AVORTEMENT DE L’ÉTAT PALESTINIEN
Vers le partage de la Palestine – Appui de Truman, hostilité de Marshall – Proclamation de l’État d’Israël – La guerre de 1948 –
Climat de méfiance dans le camp arabe – Deir Yassine – Avortement de l’État palestinien – Naissance du problème des réfugiés palestiniens – « La démographie, c’est la bombe atomique arabe »
ANDRÉ VERSAILLE : La Ligue arabe appelle à la lutte totale contre l’entreprise sioniste. Comment ressent-on la chose dans le Yichouv ?
SHIMON PERES : Ce n’est pas vraiment une surprise : nous savions que les Arabes n’allaient pas baisser les bras et que le combat se poursuivrait encore longtemps. À ce moment, Ben Gourion va vouloir que nous nous préparions à la guerre car il est convaincu que, même si le futur État juif se créait en toute légalité, les Arabes allaient nous attaquer. Dès lors, il n’y avait plus qu’une minorité pour croire à la possibilité d’un compromis avec les Arabes : ceux qui défendaient l’idée d’un État binational, ce qui pour la majorité du Yichouv était absolument exclu.
ANDRÉ VERSAILLE : Aujourd’hui, avec le recul historique, pensez-vous qu’un État binational aurait pu être une solution ? Qu’elle aurait épargné bien des guerres ?
SHIMON PERES : Non, je pense que c’était une utopie. Pour s’en convaincre, il suffit de voir les difficultés auxquelles ont été confrontés les États bi- ou multi- nationaux comme le Liban ou l’ex-Yougoslavie. On ne peut pas construire une démocratie dans un pays où c’est la démographie qui dicte sa loi. Si dans un État la majorité et la minorité politiques appartiennent au même peuple, la démocra- tie peut fonctionner ; mais si majorité et minorité sont divisées selon une ligne de partage national ou ethnique, la politique sera inévitablement teintée d’ethnicité et la démocratie sera bafouée.
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Je partage votre point de vue. Je crois qu’il aurait été très difficile de faire cohabiter deux peuples si différents. Bien plus, on aurait eu le sentiment d’une nouvelle colonisation. Il n’est qu’à voir les problèmes des pieds-noirs en Algérie, alors qu’à la différence des Juifs en Palestine, les Français étaient implantés en Algérie depuis plusieurs générations. Nous aurions connu une situation semblable : d’un côté, des colons dominateurs, soutenus par les puissances coloniales ou ex-coloniales, de l’autre, des « indigènes » avec en toile de fond des cultures et des traditions extrêmement différentes.
Mais vous dites, Shimon, que, dans une démocratie, la démographie ne peut pas dicter sa loi. Si l’on suit votre raisonnement, Israël, qui est un État spécifiquement juif où la majorité est juive, et la minorité, arabe, ne peut donc pas être considéré comme totalement démocratique.
SHIMON PERES : C’est vrai. La démocratie ne suppose pas seulement que l’État gouverne selon le vœu de la majorité, mais également dans le respect des droits de la minorité. Nous savons qu’Israël ne pourra se considérer comme une nation totalement démocratique qu’à la condition que les droits des non-Juifs soient garantis de manière absolue.
ANDRÉ VERSAILLE : En 1946-1947, la question de la garantie des droits des Arabes était-elle une préoccupation d’une partie du Yichouv, ou bien l’urgence de construire l’État juif l’emportait-elle sur toute autre considération ?
SHIMON PERES : Ce n’est pas comme cela que se posait la question : le plan de partage prévoyait la création de deux États et il était évidemment prévu que chacune des populations de ces deux États serait très largement « homogène ». La question du respect des droits de la minorité ne se posait donc pas.
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Je ne vous suis pas. Le partage de la Palestine aurait certainement laissé une minorité arabe dans l’État juif et probablement une minorité juive dans l’État arabe. La preuve en est que beaucoup d’Arabes sont restés en Israël. Et je ne vois pas au nom de quoi on les en aurait chassés alors qu’ils y avaient leur maison, quand bien même un État palestinien se serait créé. À moins bien sûr que l’on ne procède à un « nettoyage ethnique ». Que cette question n’ait pas été abordée ne signifie pas qu’elle ne se serait pas posée si deux États avaient été créés.
ANDRÉ VERSAILLE : En 1947, le mandat britannique touche à son terme. Comment cette période de transition est-elle vécue sur le terrain ?
SHIMON PERES : Nous sentions clairement que l’avènement de l’État juif était proche. Après la fin de la persécution des Juifs en Europe, cette perspective faisait de 1947 une année exaltante. Exaltante, mais certainement pas dépourvue d’énormes difficultés qui, cette fois, ne provenaient ni des Arabes ni des Anglais, mais de nous-mêmes. En effet, plus nous sentions l’échéance se rapprocher, plus les divisions politiques à l’intérieur du Yichouv se faisaient âpres. La droite dite « sécessionniste » (Irgoun et Lehi) refusait d’obtempérer à la direction élue du Yichouv et prétendait poursuivre la lutte armée tant que la totalité de la Palestine ne serait pas accordée aux Juifs. À gauche, la décision de Ben Gourion de dissoudre les troupes de l’organisation militaire indépendante Palmach, pour les incorporer à la Haganah, provoqua des dissensions entre par- tis mais aussi à l’intérieur même du Mapaï de Ben Gourion.
En fait, Ben Gourion était confronté à une difficulté double et contradictoire : il fallait hâter le départ des Anglais et mettre sur pied de façon concomitante une véritable armée nationale sous un commandement unifié, chose indispensable si l’on voulait défendre efficacement le jeune État contre les armées arabes qui n’allaient pas manquer de déferler sur nous ; en même temps, il s’agissait de se dépêcher de construire les structures du futur État juif, de manière à ce que, le moment venu, un État souverain, mais également démocratique, puisse voir le jour sans trop de difficultés et soit capable d’accueillir les immigrants juifs qui voulaient s’établir en Eretz Israël.
ANDRÉ VERSAILLE : Le 1er septembre 1947, la Commission spéciale des Nations unies pour la Palestine, l’UNSCOP, remet son rapport à l’Assemblée générale de l’ONU. Ce rapport conclut unanimement à la nécessité de mettre fin au mandat britannique sur la Palestine, et par 8 voix sur 11, se déclare en faveur du partage de la Palestine en deux États.
Les Juifs vont alors entreprendre une vaste campagne aux États-Unis et faire le siège de Washington afin de gagner les Américains à leur cause. Et ils obtiendront finalement leur appui. Comment expliquez-vous que les Juifs, dont une grande partie de la population vient d’être décimée, aient pu l’emporter sur les Arabes pourtant bien plus nombreux et représentant une force ainsi qu’un enjeu géopolitique d’une tout autre signification ? Les Arabes ne semblent d’ailleurs pas avoir perçu l’importance ni du rang ni du rôle des États-Unis.
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’à cette époque, les Arabes n’ont que très peu de contacts avec le monde extérieur, et sont dépourvus de cette culture de l’international que les Juifs possèdent. Il est vrai que les Juifs ont été décimés, mais ceux qui ont échappé au génocide, les Juifs américains entre autres, et qui faisaient partie de la diaspora active, étaient, eux, rompus aux contacts internationaux. Les Juifs qui ont fait avancer la cause sioniste appartenaient à une élite en provenance de pays extrêmement avancés. Le cosmo- politisme des Juifs, qu’on leur a par ailleurs reproché, leur a donné une véritable connaissance des mécanismes de la communauté internationale, alors que les Arabes gardaient une mentalité provinciale. Savez-vous que jusqu’au milieu des années cinquante, un Égyptien qui émigrait était très mal vu, l’émigration étant considérée comme une trahison ? L’idée qu’une diaspora égyptienne puisse constituer une force susceptible d’être utilisée n’apparaîtra que beaucoup plus tard. Les situations respectives des diasporas étaient également différentes : contrairement à la diaspora juive qui a toujours été très solidaire, la diaspora arabe, les « turcos », avait émigré en Amérique latine pour fuir le sous-développement du Machrek avec lequel elle ne conservera guère de liens très solides.
Les Arabes avaient donc beau être bien plus nombreux que les Juifs, ils n’avaient ni leurs réseaux ni leur connaissance de la diplomatie internationale moderne.
Ce handicap des populations arabes et plus généralement musulmanes peut partiellement s’expliquer par l’histoire de l’Empire ottoman où les Affaires extérieures étaient souvent confiées à des non-Musulmans, issus de minorités (Juifs, Bulgares, Grecs, Arméniens, etc.).
ANDRÉ VERSAILLE : Pour quelles raisons les États-Unis vont-ils soutenir les sionistes ?
SHIMON PERES : Il faut d’abord prendre en compte l’importance de la Bible aux États-Unis : des dizaines de millions d’Américains ont été élevés non seulement avec le Nouveau Testament mais aussi avec l’Ancien. Et pour beaucoup d’entre eux, comme pour la plupart des partis religieux, le retour des Juifs dans leur patrie ancestrale témoigne de l’accomplissement des visions des Prophètes.
Par ailleurs, tout le monde sait que les États-Unis comptent une très agissante communauté juive, et celle-ci s’est massivement engagée dans la cause sioniste. Parmi ces Juifs, certains faisaient partie du cercle des intimes de Truman, et plusieurs lui avaient apporté une aide importante lors de sa campagne présidentielle, ce qui n’a pas peu contribué à son élection. De manière générale, je pense que le soutien américain à la cause sioniste est pour une bonne part le fait du Président. Non seulement Truman avait plusieurs amis juifs très influents, mais il semble avoir été personnellement très ému par les persécutions que les Juifs venaient de subir pendant la guerre ; le projet sioniste lui semblait donc être de nature à « résoudre la question juive ». En même temps, séduits par l’état d’esprit travailliste qui régnait dans le Yichouv, les syndicats ont également apporté leur soutien aux sionistes. Enfin, le fait que l’URSS allait se prononcer en faveur des sionistes ne pouvait pas laisser Washington indifférent.
ANDRÉ VERSAILLE : Pour autant, le combat n’était pas gagné puisque le très important ministre des Affaires étrangères américain, George Marshall, l’homme du Plan qui porte son nom, s’opposait absolument à l’idée de création d’un État juif au Moyen-Orient. Selon lui, cette implantation provoquerait des guerres interminables dans lesquelles les États-Unis risquaient d’être entraînés. Marshall ira jusqu’à menacer Truman de ne pas le soutenir lors des prochaines élections s’il persistait dans son appui au plan de partage de la Palestine...
SHIMON PERES : Marshall, le secrétaire d’État Acheson, et le ministre de la Défense Forestal, étaient opposés à la création d’un État juif. D’une part, ils estimaient que cet État ne serait pas viable ; d’autre part, ils pensaient que la rancœur et l’opposition des Arabes seraient insurmontables. Marshall nous res- tera d’ailleurs très défavorable après la création d’Israël. Je me souviens qu’au lendemain de la proclamation de l’État juif, il a immédiatement appelé Moshé Sharett, alors ministre des Affaires étrangères, pour l’enjoindre de ne pas faire de Jérusalem notre capitale. Évidemment, Ben Gourion a aussitôt transféré à Jérusalem le gouvernement provisoirement établi à Tel-Aviv...
BOUTROS BOUTROS-GHALI : L’instabilité chronique de cette région, les événements des soixante dernières années, les tragédies quotidiennes auxquelles on assiste en Palestine et, enfin, le fait que l’on ne voit toujours pas se dessiner de solution, montrent que Marshall avait vu juste.
SHIMON PERES : Marshall aurait eu raison, si les turbulences au Moyen- Orient avaient toutes été la résultante de la création de l’État d’Israël. Mais il n’en est évidemment rien. Ce n’est pas Israël qui a déstabilisé le Moyen-Orient, loin s’en faut. Celui-ci est surtout instable du fait des dissensions et des guerres interarabes et arabo-musulmanes (au demeurant bien plus meurtrières que les conflits avec Israël). Prenez la seule guerre irano-irakienne : elle dura sept ans et fit un million de victimes... Peut-on la relier à Israël ? Il y a eu bien d’autres guerres : la guerre égypto-yéménite, la guerre civile soudanaise, etc. La liste est longue. Cette vision d’un Moyen-Orient déstabilisé par l’établissement de l’État juif relève d’une vision faussée de l’Histoire.
ANDRÉ VERSAILLE : En 1947, la guerre froide a commencé. Étonnamment, l’une des seules questions sur laquelle Américains et Soviétiques se retrouveront sera précisément celle du partage de la Palestine. Comment s’explique cette convergence de vues ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Alors que pour nous, Arabes, l’implantation d’Israël s’apparentait à une forme de néo-colonialisme, les Américains considéraient que la création d’un État juif et d’un État arabe indépendants dans une colonie britannique allait dans le sens de leur politique anticoloniale. Les Russes, quant à eux, pensaient que l’existence d’un État juif leur permettrait de prendre pied dans cette région, fief du monde occidental capitaliste.

SHIMON PERES : Disons que les Soviétiques voulaient voir le Moyen-Orient débarrassé des Anglais et de manière générale des puissances coloniales occidentales. Dès lors, n’importe quelle situation susceptible de contribuer au départ des Britanniques avait leur suffrage.
ANDRÉ VERSAILLE : En septembre 1947, les Britanniques déclarent qu’ils vont progressivement quitter la Palestine. Comment l’annonce de ce départ est-elle vécue sur place ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Au moment où les Britanniques s’apprêtent à quitter la Palestine, ils occupent toujours l’Égypte et la Jordanie. C’est une contradiction difficilement compréhensible pour les Arabes : ceux-ci sont donc persuadés que les Juifs vont remplacer les Britanniques dans leur rôle de colonisateurs.
SHIMON PERES : Pour notre part, nous étions ravis. Ce départ allait dans le sens d’une libération de la Palestine.
ANDRÉ VERSAILLE : Vous ne craigniez pas que l’évacuation des troupes britan- niques, qui constituaient tout de même un tampon entre les Arabes et les Juifs, entraîne le déclenchement de violentes hostilités de la part des Arabes ?
SHIMON PERES : Ce déclenchement était inéluctable et nous en étions conscients. Le départ des Anglais avait l’avantage de clarifier la situation sur le terrain, d’autant plus que nous considérions les Britanniques plus proches des Arabes que de nous. Non sans raison puisque tous les jours, l’armée anglaise faisait la chasse aux combattants juifs, qu’ils fussent de la Haganah, du Lehi ou de l’Irgoun. Chaque jour on voyait des Bérets rouges fouiller des villages juifs à la recherche de caches d’armes. J’ajouterais que Londres était objectivement très engagé aux côtés de la Transjordanie.
ANDRÉ VERSAILLE : Finalement, le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations unies se prononce majoritairement en faveur de la partition : concrètement, 55 % de la Palestine sont alloués aux Juifs qui ne constituent pourtant que 37 % de la population et ne possèdent que 7 à 8 % du territoire. Un statut international est réservé pour Jérusalem et Bethléem. Notons en passant que la majorité onusienne n’est pas énorme : trente-trois pays se sont pro- noncés en faveur du partage contre treize, tandis que dix pays se sont abstenus. Compte tenu du nombre de suffrages requis, la résolution était rejetée à trois voix près. Quel est alors l’état d’esprit dans les chancelleries arabes ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Pour le monde arabe, la Palestine est indiscutablement une terre arabe, au même titre que Bahreïn ou le Yémen. Et la Palestine qui, à l’instar des autres pays arabes colonisés, veut s’émanciper se voit brusquement amputée de plus de la moitié de son territoire. Cette situation est donc vécue comme une injustice intolérable. Au moment où l’on pense que l’ère coloniale est en passe de s’achever, que le processus de décolonisation est bien entamé (l’Inde vient d’acquérir son indépendance), voilà que des Européens s’implantent en terre arabe, avec l’intention d’y créer un État occidental. Pour nous, il s’agit d’évidence d’un fait colonial : c’est le retour du royaume des Croisés, sous la forme, cette fois-ci, d’une alliance judéo-chrétienne, et c’est insupportable. En signe de protestation, les représentants des pays arabes à l’ONU quittent l’Assemblée générale en déclarant nulle la résolution qui vient d’être votée.
ANDRÉ VERSAILLE : Ce qui n’empêchera pas six mois plus tard, le 14 mai 1948, la proclamation de l’État juif. Shimon Peres, quel souvenir gardez-vous de ce moment ?
SHIMON PERES : Ce jour-là, j’étais avec quelques amis aux côtés de Ben Gourion. Immédiatement, les États-Unis et l’Union soviétique, suivis par plusieurs nations, reconnurent le nouvel État. Dans la rue, les gens chantaient et dansaient. La population était très excitée. Mais les sentiments étaient mélangés : une appréhension légitime pointait sous la joie d’y « être enfin parvenu », d’avoir réussi le « miracle » après tant de souffrances inimaginables.
Ben Gourion, lui, présentait un visage triste. Il ne parlait pas beaucoup. Il y avait un étonnant contraste entre son inquiétude et les cris de joie que nous entendions éclater un peu partout. Il avait le regard lourd, comme si finalement l’avènement de l’État pour lequel il avait tant combattu ne représentait plus rien. Il écoutait les bruits du dehors avec un sourire mélancolique. Et puis je l’ai entendu dire : « Tous les gens qui chantent ce soir ne se rendent pas compte que demain la guerre va commencer. Demain il y aura du sang et des larmes... Les institutions internationales sont impuissantes ; c’est par la guerre que l’État d’Israël se réalisera. »
ANDRÉ VERSAILLE : Du côté arabe, c’est la colère et la consternation. Jean Lacouture raconte que le jour de la proclamation de l’État d’Israël, il est au Maroc où il a été invité comme journaliste au palais du sultan Mohammed Ben Youssef, à l’occasion de la visite du général Juin. Surpris par l’atmosphère générale de désastre qui règne au Palais (il parle même d’un « mélange de deuil et de honte »), il en demande la raison à son compatriote, le grand arabisant Jacques Berque, également présent. Celui-ci lui explique qu’un État juif vient de s’implanter en Palestine et que ce fait est ressenti comme une « insupportable humiliation ». « À plus de quatre mille kilomètres d’ici ? », demande Lacouture. « Il s’agit d’une terre “arabe”, répond Berque, et tout Arabe dans le monde ne peut être que blessé par la création d’un État juif en terre arabe. » Qu’est-ce qui est tellement « insupportable », tellement « humiliant » ?

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Dans l’esprit des Arabes, ces Juifs sont des citoyens issus de puissances coloniales avec lesquelles ils gardent des liens forts. Israël est une « colonie dont la métropole est diffuse », comme le disait avec humour Edgar Faure. La création d’un État juif en terre arabe vient rompre une continuité géographique, et les Arabes craignent que l’établissement de réseaux internationaux occidentaux ne contribue à les maintenir dans un état de tutelle. Le problème n’est pas tant que cet État soit juif, c’est surtout qu’il soit non arabe. À titre de comparaison, je dirais que cette implantation non arabe était aussi préoccupante que le fut celle des pieds-noirs en Algérie.
ANDRÉ VERSAILLE : Immédiatement après la proclamation de l’État d’Israël, sept armées arabes, dont l’égyptienne, la syrienne, la transjordanienne et l’irakienne attaquent Israël.
SHIMON PERES : Oui, bien que la création de l’État d’Israël fût légale, puis- qu’une majorité de trente-trois États avait voté en faveur du plan de partage, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France allaient imposer un embargo sur la vente d’armes dans la région (de la Palestine et d’Israël), ce qui nous mettra en très grande difficulté étant donné que les Arabes étaient dès le départ bien plus armés que nous. Les États-Unis nous soutenaient, mais pas au point de nous fournir des armes pour nous défendre. Une quinzaine d’années plus tard, alors ministre de la Défense, j’étais invité à déjeuner à la Maison-Blanche par l’envoyé spécial Averell Harriman. Celui-ci voulut bien admettre que l’embargo fut une « erreur ». Je lui fis tout de même remarquer que ce qui pour les États-Unis ne fut qu’une « erreur » faillit être fatal pour notre tout jeune État... L’Occident avait beau applaudir le petit Israël, il ne nous laissait pas moins isolés et militairement très démunis face aux Arabes.
ANDRÉ VERSAILLE : Un embargo sur les armes à destination de la Palestine est décrété, mais un pays fournira (secrètement) des armes à l’État juif : c’est la Tchécoslovaquie, un pays communiste.
SHIMON PERES : Oui, par une ironie de l’Histoire, c’est un pays communiste qui nous a soutenus militairement. Les Tchèques nous ont vraiment aidés : ils nous ont vendu des armes de toutes les catégories, jusqu’aux avions Messerschmitt ; ils ont permis à nos parachutistes de s’entraîner sur leur sol ; ils ont accepté de nous servir de point de transit pour les avions que nous sortions en contrebande des États-Unis, etc. Qu’est-ce qui a convaincu Prague d’établir des relations secrètes extrêmement serrées avec nous ? Est-ce le fait que le dirigeant, Rudolf Slansky, bien que communiste pur et dur, se soit tout de même senti solidaire de cette com- munauté juive (à laquelle il appartenait lui-même) qui essayait de revivre ? Est-ce dû à l’habileté diplomatique de Shmuel Mikunis, responsable du Parti communiste israélien, qui avait réussi à obtenir du Kremlin qu’il permette à son satellite de faire une brèche dans l’embargo ? Est-ce l’exceptionnel entregent de Ehud Avriel, notre ambassadeur à Prague ? Tous ces facteurs ont dû jouer dans des proportions que nous ne connaîtrons jamais. Ajoutons tout de même que la Tchécoslovaquie traversait alors une passe économique difficile et, qu’en tant que fabriquant d’ar- mes, elle ne voyait pas d’un mauvais œil l’ouverture d’un nouveau marché. Et sans doute le paiement cash des livraisons, en dollars américains, devait-il ampli- fier le mouvement de bonne volonté originelle.
Durant toute cette guerre, notre principal problème fut l’acquisition des armes. Pour contourner l’embargo, nous avons dû recourir à toute une série de stratagèmes. Ainsi des Israéliens eurent-ils entre autres l’idée de fonder une société productrice de films en Angleterre : prétendant devoir tourner une séquence de film de guerre, ils louèrent trois avions. Une fois les caméras en place, les appareils décollèrent... et mirent le cap sur Israël.
ANDRÉ VERSAILLE : Si, d’une certaine manière, Prague obéissait à la volonté de Moscou, pourquoi l’URSS n’a-t-elle pas fourni elle-même des armes ?
SHIMON PERES : Le Kremlin a toujours été prudent et je pense qu’il préférait rester dans l’ombre pour ne pas s’aliéner les Arabes.
ANDRÉ VERSAILLE : La guerre se déroule, mais dans le camp arabe la méfiance semble régner entre les différents partenaires de la Ligue. Ainsi le Palestinien Amin al-Husseini craint-il que l’intervention de l’Égypte, de la Syrie et de la Transjordanie n’ait pour conséquences l’annexion de territoires palestiniens par chacun de ces pays limitrophes. Il semble surtout se méfier du roi Abdallah de Transjordanie et craindre que celui-ci ne profite de la guerre pour en tirer un avantage territorial.
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Il y a effectivement, à ce moment, un manque de coopération réelle entre les États arabes. N’ayant accédé à l’indépendance que très récemment, ils avaient entretenu peu de relations : l’interdiction faite aux colonies de communiquer directement entre elles entravait l’émergence d’une solidarité tiers-mondiste ou panarabe. Les contacts étaient verticaux : Alger- Paris, Delhi-Londres, en aucun cas Delhi-Alger ou Alger-Le Caire. Il n’était par exemple pas possible pour un Égyptien de se rendre directement en Algérie. Ainsi, en ce qui me concerne, c’est à Paris, où je faisais mes études au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que j’ai pu nouer des contacts avec des Maghrébins ; et ce n’est qu’après l’indépendance de l’Algérie que j’ai pu m’y rendre pour la première fois. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l’influence des ex-puissances coloniales alors encore très importante dans certains pays arabes : elles ont savamment entretenu une rivalité entre ces États.
ANDRÉ VERSAILLE : Depuis deux ans, Abdallah est en négociation secrète avec l’Agence juive. Il semble qu’il fut favorable à la partition de la Palestine – mais entre les Juifs et lui.
BOUTROS BOUTROS-GHALI : C’est exact. Abdallah caressait alors le projet d’annexer la Cisjordanie. À cette époque, les dirigeants arabes de la région ne marchent pas du même pas. La Ligue arabe se partageait en deux courants : d’un côté le courant hachémite (Transjordanie-Irak) en faveur de l’annexion de la Cisjordanie afin de constituer un grand royaume ; de l’autre, le courant égypto-saoudien partisan de la création d’un État palestinien indépendant.
SHIMON PERES : Pour Abdallah et toute sa famille, les Palestiniens consti- tuaient un ferment de désintégration de l’État hachémite. Il était persuadé que les Palestiniens, dont la majorité était issue de Transjordanie, regardaient son royaume avec appétit et en menaçaient l’intégrité. C’est ce qui explique qu’il nous faisait plus confiance qu’aux Palestiniens. Golda Meir le rencontrera en 1947 pour essayer de conclure un accord, mais cet événement qui aurait été spectaculaire ne s’est pas produit.
ANDRÉ VERSAILLE : Sur le papier les Arabes sont deux fois plus nombreux que les Juifs (1,2 million à 1,3 million contre 650 000) et plus armés. Pourtant ce sont les forces israéliennes qui vont l’emporter. Comment cela s’explique-t-il ? Supériorité de l’entraînement ? de l’organisation ? de la motivation ? différence de mentalité : d’un côté une société traditionnelle pour laquelle l’indépendance politique et l’État-nation restent encore des valeurs abstraites ; de l’autre, un idéal nationaliste fort, consolidé par l’expérience du Génocide ?
SHIMON PERES : La victoire ne fut pas le fait d’une supériorité de l’entraî- nement mais certainement de la détermination. Les Israéliens étaient dos au mur, ou plutôt à la mer. Ne pouvant se réfugier ni même se retirer nulle part ailleurs, ils étaient conscients qu’une défaite militaire aurait entraîné une nouvelle Shoah. Nous ne luttions pas seulement pour notre indépendance mais éga- lement pour nos vies. Cette guerre fut une « guerre sans alternative ».
Je pense qu’il faut également prendre en compte la force du sentiment natio- nal. C’était plus qu’une guerre rationnelle pour un territoire. Nous avions vraiment la sensation d’enfin bâtir notre pays. Prenons l’exemple de la bataille de Jérusalem : celle-ci fut privilégiée, alors que plusieurs généraux estimaient qu’il fallait concentrer toutes les forces dans le Néguev, étant donné son enjeu militaire. Néanmoins, Ben Gourion, considérant que Jérusalem était la clef de notre avenir, fit de ce combat une priorité.
ANDRÉ VERSAILLE : Il semble que les armées arabes ne s’étaient pas vraiment préparées à la guerre (Glubb Pacha, commandant britannique de l’armée trans-jordanienne, affirmera même qu’il n’y avait aucune préparation commune de quelque nature que ce soit). Les autorités arabes avaient-elles supposé que la victoire serait aisée ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Oui, je pense que les États arabes étaient persuadés, vu leur supériorité numérique, qu’ils étaient en mesure de gagner rapidement la guerre contre des colons dépourvus d’une armée organisée. Les Arabes ont incontestablement sous-estimé les forces et la détermination israéliennes.
Et puis nous en revenons toujours au même point, à savoir que vous avez affaire à des populations qui ne sont pas entrées dans la modernité, qui restent encore dans le sous-développement, et ne parviennent que très mal à s’organi- ser militairement. Organiser une coalition demande un degré de sophistication militaire et un sens de la synchronisation qui n’étaient manifestement pas à la portée des états-majors arabes de l’époque. Sans compter les rivalités entre Saoudiens et Hachémites, et les diverses ambitions particulières.
ANDRÉ VERSAILLE : Le 9 avril 1948, avant la création de l’État d’Israël et l’en- trée en guerre des armées arabes, un commando de l’Irgoun va attaquer le village de Deir Yassine et massacrer sa population, soit environ deux cents habitants.
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Il s’agit d’une opération qui vise à réaliser un nettoyage ethnique comparable à celui qui aura lieu plus tard en Yougoslavie et qui, lui, sera condamné.
SHIMON PERES : C’est un massacre, mais il est clairement et, d’une manière générale, vigoureusement condamné dans le Yichouv. Sans aucune ambiguïté.
ANDRÉ VERSAILLE : L’événement sera médiatisé par les radios arabes qui gon- fleront l’horreur des faits « pour pousser les armées arabes à intervenir ». Hazem Noussaibi, journaliste à la radio palestinienne, déclarera plus tard : « Ce fut la plus tragique erreur que nous ayons commise en 1948. Manifestement nous ne comprenions pas la mentalité de notre peuple. Dès l’instant où les habitants apprirent ce qui était arrivé à Deir Yassine, ils furent pris de panique. »
Quoi qu’il en soit, Deir Yassine semble avoir eu un impact considérable, d’une part sur la population palestinienne dont une partie fuira, et d’autre part sur certains dirigeants arabes, surtout en Égypte, qui décideront de s’engager plus avant dans la guerre contre le Yichouv.
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Oui, ce massacre a eu un réel impact en Égypte, et qui va perdurer.
ANDRÉ VERSAILLE : Dans la mémoire populaire occidentale (même parmi les sympathisants d’Israël), Deir Yassine restera comme une tache sur le visage de l’aventure sioniste, même si on en exonérera la Haganah.
L’histoire officielle d’Israël prétend que la fuite des Arabes hors de Palestine est due aux appels des autorités arabes qui les ont enjoints de partir afin de faire « place nette » et permettre à leurs armées de faire la guerre aux Juifs. Cependant, depuis que les archives israéliennes se sont ouvertes, ceux que l’on a appelés les « nouveaux historiens », et d’abord le premier d’entre eux, Benny Morris, ont retouché cette histoire officielle. Ainsi Benny Morris a-t-il mis en évidence des responsabilités israéliennes dans la fuite des Arabes.
SHIMON PERES : J’ai lu ces historiens, et ce que je puis vous dire, en tant que témoin tout de même privilégié (à cette époque j’étais souvent aux côtés de Ben Gourion), c’est que Ben Gourion n’a jamais ordonné quelque expulsion que ce soit. Au contraire, il pensait que forcer les Arabes à quitter Israël aurait été une faute énorme, une erreur tragique. Ben Gourion avait une éthique. Il considérait qu’une guerre est jugée deux fois : la première sur les champs de bataille, la seconde par l’Histoire. Et pour rien au monde il n’aurait voulu que, dans les livres d’Histoire, son nom soit associé à des expulsions d’Arabes.
En revanche, des discours enflammés à la radio, appelant les Arabes à quitter leurs villages pendant qu’on allait « jeter les Juifs à la mer », n’ont pas été rares et sont le fait de dirigeants comme le mufti de Jérusalem.
Ceci étant, il est évident que, comme dans toute guerre, il y a eu des exactions, mais celles-ci furent le fait d’initiatives isolées et subalternes et non pas ordonnées par les autorités militaires ou politiques.
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Je ne partage pas du tout votre interprétation. Vous nous resservez la version officielle destinée à masquer le nettoyage ethnique auquel s’est livrée l’armée israélienne. Comme le rappelle André Versaille, les nouveaux historiens israéliens ont eu le courage de reconnaître les responsabilités israéliennes. Saluons à cet égard le courage de Benny Morris.
ANDRÉ VERSAILLE : Les sionistes ayant pour but de créer un État spécifiquement juif, et les Juifs n’étant pas encore très nombreux en Israël, n’était-il pas clair pour tout le monde que moins il y aurait d’Arabes sur ce territoire, mieux ce serait pour l’avenir du pays ? Dès lors, même si les ordres n’étaient pas explicitement donnés, un consensus tacite n’existait-il pas au sein de l’armée ?
SHIMON PERES : Quand bien même, en quoi cela prouve-t-il que des expulsions ou des massacres aient été commis ? Vous évoquez Deir Yassine : mais Deir Yassine est justement l’une des rares exceptions qui confirment la règle. Je peux vous dire que Ben Gourion voulait, dans toute la mesure du possible, que cette guerre se fasse sans effusion inutile du sang de l’ennemi ; que les armes ne soient pas souillées.
ANDRÉ VERSAILLE : Et cela vous semble-t-il possible ? Pouvez-vous conce-
voir que l’on puisse guerroyer proprement ?
SHIMON PERES : Je ne dis pas que l’on peut faire une guerre propre, mais je pense que l’on peut se donner pour principe de refuser de faire la guerre salement. Il y aura toujours des saletés, mais elles seront alors exceptionnelles et le fait d’initiatives personnelles, non une façon générale de se conduire militairement.
ANDRÉ VERSAILLE : En 1949, la guerre terminée et les armistices signés, Israël se retrouve avec un territoire bien plus grand que celui qui lui avait été alloué par les Nations unies. Pour autant, ses frontières ne sont que des lignes d’armistice.
Israël a conquis 6 300 km2. Ce nouvel État fait 20 000 km2, et avec l’afflux des immigrants compte une population d’environ 850 000 à 900 000 personnes, dont quelque 150 000 Arabes. Il est entouré de quatre États arabes hostiles : l’Égypte (un million de km2, 20 millions d’habitants), le Liban (10 000 km2, 1,2 million d’habitants), la Syrie (190 000 km2, 3 millions d’habitants), la Jordanie (97 000 km2, 150 000 habitants). (Précisons tout de même que les statistiques démographiques du monde arabe de l’époque sont fort peu fiables.)
Comment les Israéliens perçoivent-ils l’agrandissement de leur pays ? Certains pensent-ils qu’il faudra restituer ces territoires, ou bien cette nouvelle configuration géopolitique qui annule l’État palestinien (avec la « complicité objective » de l’Égypte et de la Transjordanie qui occupent respectivement la bande de Gaza et la Cisjordanie) est-elle considérée comme un fait accompli imposé par l’Histoire ?
SHIMON PERES : En 1949, nous estimions que le plan de partage n’était de toute façon pas viable : d’une part, les deux territoires étaient trop imbriqués, et d’autre part, nous avions besoin de frontières défendables. Ces nouvelles lignes d’armistice nous paraissaient mieux convenir que le tracé de frontières prévu par le plan de partage. Nous avions accepté ce plan de partage, mais comme il ne fut pas respecté par les Arabes qui venaient de nous agresser, nous n’avons eu aucun scrupule à nous installer à l’intérieur de ces nouvelles frontières.
ANDRÉ VERSAILLE : De leur côté, comment les États arabes regardent-ils cette nouvelle réalité israélienne née de l’armistice ? À l’époque – et pour très longtemps –, les gouvernements arabes ne reconnaissent pas l’État d’Israël (qu’ils qualifient d’« entité sioniste »). Les Arabes pensent-ils à cette époque qu’Israël n’est qu’un État provisoire ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Oui, nombreux sont alors les Arabes (mais aussi des non-Arabes) à penser qu’Israël est un État éphémère qui disparaîtra comme le royaume des Croisés, un État destiné à être englouti par l’explosion démographique arabe.
ANDRÉ VERSAILLE : La conséquence la plus tragique de cette première guerre est la destruction de la société palestinienne et la naissance du problème des réfugiés dont le nombre se situerait aux environs de 700 000. Ils se retrouvent partagés entre la bande de Gaza (200 000), la Jordanie (environ 350 000, principalement en Cisjordanie), le Liban (100 000) et la Syrie (60 000). La moitié des réfugiés s’établit dans des villes et des villages existants, l’autre moitié s’installe dans des camps. Enfin, les tracés des lignes d’armistice vont séparer des membres de mêmes familles.
Comment se passent alors les relations entre Juifs et Arabes à l’intérieur du nouvel État juif ?
SHIMON PERES : Compte tenu de la situation, les relations sont les meilleures possibles. La minorité arabe ne voulait absolument pas passer pour une cinquième colonne et de fait, elle restera loyale à l’État. C’est ce qui explique que nous traverserons les guerres suivantes sans trop de difficultés intérieures.
ANDRÉ VERSAILLE : Le 22 septembre 1948, le Haut Comité arabe avait proclamé l’établissement à Gaza, alors sous autorité égyptienne, du « Gouvernement de toute la Palestine », avant de créer, huit jours plus tard, un Conseil national palestinien. Pendant ce temps-là, le roi Abdallah convoque à Amman le « Premier Congrès palestinien » qui fait de facto concurrence au « Gouvernement de Gaza » – qu’il dénonce d’ailleurs. En fait, le « Gouvernement de toute la Palestine » n’aura qu’une existence virtuelle en tant que subdivision de la Ligue arabe jusqu’en 1959, lorsque Nasser le dissoudra officiellement.
Comment cela s’explique-t-il ? Que représentent alors les Palestiniens pour les États arabes ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : L’existence même de deux autorités qui veulent représenter la Palestine est une preuve supplémentaire de la division du monde arabe entre le courant hachémite et le courant égypto-saoudien que je mention- nais précédemment.
ANDRÉ VERSAILLE : De quelle autonomie, de quelle liberté de manœuvre ce « gouvernement » jouit-il ? Ne sommes-nous pas dans une situation que l’on peut qualifier de « coloniale » ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Absolument pas ! D’une part, l’Égypte n’a jamais songé à annexer ce territoire ; d’autre part, les Palestiniens ne se sont pas sentis traités comme des colonisés : il s’agit là de conflits « inter-arabes ». Même si c’est difficile à comprendre, lorsqu’un État arabe « occupe » ou « protège » une autre population ou un autre État arabe, il n’est pas considéré comme colonia- liste. En revanche, quand un État occidental « occupe » ou « protège » un État arabe, cette situation est vécue comme coloniale.
ANDRÉ VERSAILLE : Vous voulez dire que peu importe que la situation soit ou non objectivement coloniale, si le peuple en situation de colonisé n’éprouve pas ce sentiment ? C’est ce qui expliquerait que personne ne proteste contre l’occupation des territoires palestiniens non conquis par les Israéliens d’un côté par l’Égypte, de l’autre par la Transjordanie (qui devient alors la Jordanie) et qu’il faudra attendre la défaite arabe de juin 1967 et la conquête de ces mêmes terrioires par les Israéliens pour que l’on parle d’« occupation » ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Parce que c’est tout à fait différent : contrairement aux Israéliens, ni les Égyptiens ni les Jordaniens n’ont parlé d’annexer ces territoires et ont toujours défendu l’entité palestinienne. Leur présence se justifiait, en outre, pour empêcher un nouvel expansionnisme israélien.
ANDRÉ VERSAILLE : La Transjordanie a quand même annexé la Cisjordanie pour devenir la Jordanie ; quant à l’Égypte, elle a annexé de fait la bande de Gaza. Et de toute manière, ces territoires sont restés sous occupation pendant près de vingt ans.
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Ce n’est pas pareil ! Les autorités palestiniennes avaient une autonomie inconcevable dans une situation d’occupation. Elles participaient aux réunions de la Ligue arabe, nouaient des relations internationales, etc.
ANDRÉ VERSAILLE : Comment expliquez-vous qu’au lendemain de l’armistice de 1949, les Palestiniens vivant en Égypte, en Syrie et au Liban ne pourront pas acquérir la citoyenneté de leur pays et seront traités comme des citoyens de seconde catégorie ? Amman, quant à elle, va octroyer la citoyenneté aux Palestiniens qui ont immigré dans le royaume hachémite. Pour autant, la situation des Palestiniens en Jordanie – même si ceux-ci représentent alors la majorité de la population – n’est pas idéale : les formations de combat de la Légion arabe leur sont interdites, et il leur est particulièrement difficile d’obtenir des postes élevés dans l’administration civile. Qu’est-ce qui explique que les réfugiés palestiniens n’aient pas été mieux accueillis par les pays arabes ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Prenons le cas de l’Égypte : les Palestiniens n’ont pas été traités comme des citoyens de seconde catégorie, mais comme des Arabes étrangers. Gaza étant considéré comme un autre pays, les Gazaouites ne pouvaient donc pas plus s’établir librement au Caire ou à Alexandrie que des Syriens ou des Libanais. Gaza aurait parfaitement pu être annexé par l’Égypte, mais nous tenions à maintenir cette bande comme une entité indépendante, prémices de l’État palestinien.
On ne peut pas dire non plus que les Palestiniens aient été considérés comme des citoyens de deuxième catégorie en Jordanie. Aujourd’hui encore, alors que la Jordanie a abandonné toute souveraineté sur la Cisjordanie, la représentation palestinienne au Parlement est importante, il y a des ministres d’origine pales- tinienne. Sans compter que l’actuel roi de Jordanie a épousé une Palestinienne, tout comme l’avait fait son père, d’ailleurs.
ANDRÉ VERSAILLE : Pensez-vous qu’un mariage royal soit significatif de la situation d’une population ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Je vous donne cet exemple parmi d’autres pour vous montrer qu’il n’y a aucune relation de type colonial entre les deux populations. Aurait-il été imaginable, par exemple, que le président français René Coty ou le général de Gaulle épousent une Algérienne ?
ANDRÉ VERSAILLE : Tout de même, qu’est-ce qui explique le désintérêt du monde arabe à l’endroit des Palestiniens jusqu’en 1967 ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : La colonisation encore et toujours : dans les années cinquante et soixante, le monde arabe est encore largement colonisé. Dans ce contexte, chaque population arabe se bat d’abord pour elle-même. Il est évident que les Algériens, pris dans leur guerre de libération contre la France, se préoccupent d’abord de leur propre émancipation avant de penser à la Pales- tine. De même, la révolution nassérienne de 1952 sera tout entière focalisée sur le redressement de l’Égypte. Par ailleurs, le monde arabe n’est pas stabilisé, certains États sont en conflit : confrontation militaire entre l’Algérie et le Maroc en 1963 ; question du Sahara, ensuite ; etc. Par la force des choses, le problème palestinien passe au second plan.
ANDRÉ VERSAILLE : Aujourd’hui on parle de la nécessité de bâtir un État palestinien sur ces mêmes territoires jadis occupés par l’Égypte et la Jordanie : qu’est-ce qui fait que l’on n’a pas créé cet État en 1949, alors que rien ne s’y opposait ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : En 1949, étant donné le déséquilibre entre un million de Juifs et cent millions d’Arabes, ceux-ci se disaient qu’il suffisait d’attendre, que dans quelques années l’État juif serait inévitablement submergé. Et dans l’imaginaire arabe, jusqu’à aujourd’hui, il reste cet espoir de « noyer » l’État juif dans une mer arabe musulmane. C’est le leitmotiv du Front du refus. Dans leur perception, les Arabes considèrent que la démographie joue en leur faveur. Il s’agit donc de résister et d’attendre...
Aujourd’hui, la majorité des Palestiniens acceptent l’idée de renoncer à un État recouvrant la totalité de la Palestine. En 1949, c’était inconcevable. À ce moment-là, le refus arabe d’Israël était total et l’établissement d’un État palestinien sur un territoire encore plus petit que celui prévu par le plan de partage revenait à entériner une situation qu’aucun pays arabe ne pouvait admettre : la libération complète de la Palestine était le préalable à la création d’un État palestinien. C’est ce qui explique que les accords d’armistice n’aient pas été suivis de traités de paix. Dès lors, les belligérants vont s’enfermer dans une négation réciproque de l’Autre qui empêchera tout dialogue : du côté arabe, l’État d’Israël, dont aucune carte arabe ne mentionnait même l’existence, est nié ; du côté israélien, le peuple palestinien n’existe pas.
ANDRÉ VERSAILLE : Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on verra de gigantesques transferts de populations. Vingt-deux millions rien qu’en Europe, de manière, dit-on, à éviter les problèmes de minorités nationales qui avaient empoisonné les relations internationales dans l’entre-deux-guerres. À l’époque cette décision semble relever de la sagesse (et, effectivement, ces pays, relative- ment plus homogènes que par le passé, ont joui d’une plus grande tranquillité). Aujourd’hui, on parlerait de « nettoyage ethnique ». Quoi qu’il en soit, en quelques années ces millions de réfugiés ont retrouvé une « vie normale ». Qu’est-ce qui fait que depuis plus de cinquante ans la majorité des Palestiniens n’ont pas été tirés de leur condition de réfugiés ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : C’est volontaire ! La démographie, c’est l’arme secrète des Arabes, leur bombe atomique. C’est l’une des raisons qui font que l’Égypte a voulu maintenir les Palestiniens à Gaza, en territoire fermé. L’université d’Haïfa a publié un rapport dans lequel il apparaît clairement qu’à l’horizon 2010, les Arabes représenteront 53 % de la population globale d’Israël (territoires arabes occupés compris).
ANDRÉ VERSAILLE : Après la guerre de 1948, il semble que, tant dans le monde arabe qu’en Israël, on pense à une deuxième manche. Jusqu’où les Arabes sont-ils prêts à rouvrir militairement les hostilités pour « sauver l’honneur arabe », « effacer les traces de l’agression sioniste » et « rendre justice au peu- ple palestinien » ?
BOUTROS BOUTROS-GHALI : Je vous répondrais que, avant 1952, les responsables égyptiens étaient partagés entre deux tendances : ceux qui voulaient poursuivre la guerre contre Israël, et ceux qui pensaient que les problèmes majeurs de l’Égypte résidaient dans ses rapports avec le Soudan et dans la gestion des eaux du Nil. Avec l’avènement de Nasser, les choses sont plus claires : la guerre avec Israël sera reprise tôt ou tard.
ANDRÉ VERSAILLE : Du côté israélien, d’aucuns prétendent que Ben Gourion aurait estimé avoir perdu l’occasion d’occuper toute la Palestine en 1948-1949, et qu’il aurait attendu un prétexte pour reprendre les armes et « achever le travail ».
SHIMON PERES : Il s’agit là d’histoire purement spéculative, qui ne se base sur rien de solide. Je vous rappelle que lors de la guerre d’Indépendance, nous avions conquis El Arish, en Égypte, et que Ben Gourion a enjoint nos forces de s’en retirer. Cette idée de chercher ou d’attendre un prétexte pour reprendre les armes est totalement fausse. D’autant plus, qu’au début des années cinquante, nous nous trouvions devant d’énormes problèmes d’accueil des réfugiés juifs en provenance surtout du monde arabe. Et je peux vous assurer que ces questions urgentes nous absorbaient beaucoup trop pour nous laisser le loisir de penser à reprendre les armes et « achever » je ne sais quel « travail »...